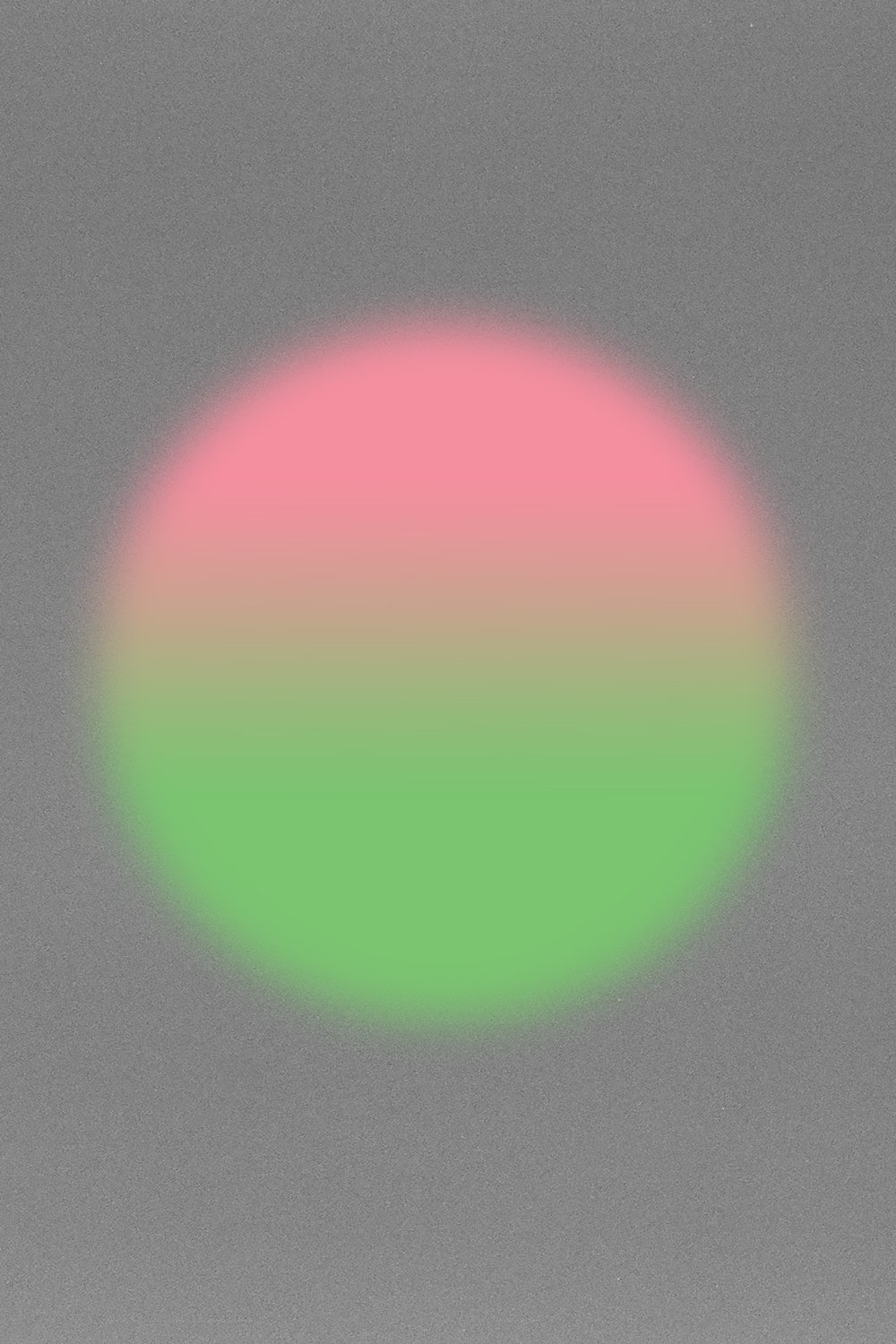Les invasions biologiques sont des processus dynamiques du vivant. La situation est sans cesse mouvante. Une espèce arrive, s’installe, prolifère à plus ou moins court terme. À long terme, elle peut devenir dominante dans certains milieux, ou finalement régresser et s’intégrer à la flore ou la faune locale. Mais la principale, pour ne pas dire la seule, caractéristique permettant de repérer une espèce exotique envahissante est sa phase d’expansion: elle est absente ou discrète, et brusquement elle prend beaucoup de place.
La prolifération n’est pas seulement le fait d’espèces «étrangères». Des espèces autochtones peuvent tout aussi bien présenter une croissance démographique inattendue sous l’influence de telle ou telle modification environnementale. C’est pourquoi des scientifiques préconisent de s’intéresser de manière globale aux mouvements et à la redistribution des espèces, sans distinction d’origine, que ce soit en raison du changement climatique, du changement d’utilisation des terres, du transport humain ou d’une combinaison de ces facteurs.— Gérard Leboucher, Dans la tête d’un oiseau, 2024.
La série EEE s’inscrit dans la continuité de ma réflexion sur la catégorisation des espèces d’oiseaux en milieu urbain.
Originaire d’Afrique centrale et d’Asie, la perruche à collier est présente en île-de-France depuis les années 1970 après avoir été introduite de façon accidentelle ou volontaire par l’homme depuis les zones aéroportuaires. Elle est facilement identifiable dans les grandes villes grâce à son plumage verdoyant ainsi qu’une gamme de cris perçants qui lui est propre.
Dès le mois de novembre, cette espèce cavicole se regroupe dans l’un des 7 dortoirs franciliens comptabilisés à ce jour, puis ils sont les premiers oiseaux à nicher pour la reproduction vers la fin de l’hiver.
En 2018, le ministère de la transition écologique classe la perruche à collier «espèce exotique envahissante» sans réelles études qui prouvent leur impact négatif. Et si l’on remarque depuis plusieurs décennies que ces vertébrés à sang chaud se sont extrêmement bien adaptée au climat européen, ils ne figurent pas pour autant sur la liste des E.E.E établie par l’UE.
Deux ans plus tard, une équipe de recherche de l’Université Paris-Saclay, du Muséum national d’Histoire naturelle, d’AgroParisTech et du CNRS1 a pu mesurer pour la première fois les effets de la présence de perruches à collier sur les autres oiseaux pour l’accès aux ressources alimentaires. Les données du programme montrent une compétitivité très relative de cette espèce et les études sur la nidification ne sont pas parvenues à démontrer une certaine concurrence avec des espèces susceptibles de loger dans les mêmes cavités.
Comme pour nos politiques migratoires, le mécanisme des mesures environnementales est de considérer que les populations venant d’ailleurs soient un phénomène négatif. Il est assez rare que la communauté scientifique s’intéresse de prime abord à leurs bénéfices comme par exemple leur contribution à la dispersion des graines ou encore leur apport en matière organique des sols. Si elle s’accorde à dire que tous les vertébrés sont sentients, ne serait-il pas l’heure d’un changement de paradigme pour passer d’une éthique environnementale à une éthique animaliste.